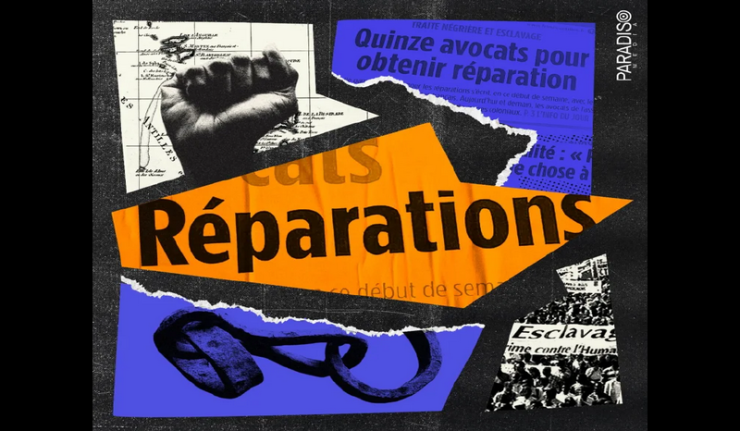Réparations coloniales : La France lance un fonds secret dans son budget 2025, au prix de sacrifices sociaux
Source : reseauinternational.net – 27 mars 2025
Abonnez-vous au canal Telegram Strategika pour ne rien rater de notre actualité
Pour nous soutenir commandez les livres Strategika : “Globalisme et dépopulation” , « La guerre des USA contre l’Europe » et « Société ouverte contre Eurasie »
Alors que l’Élysée maintient un silence stratégique, notre enquête révèle comment le budget 2025 prépare discrètement les premières réparations aux anciennes colonies africaines. Un virage historique qui s’accompagne de choix budgétaires lourds de conséquences pour les Français.
Les priorités discutables du gouvernement
La France s’apprêterait à devenir le premier pays européen à matérialiser les réparations coloniales. Si le principe peut se défendre moralement, les modalités de financement interpellent.
Alors que le secteur public français lutte pour répondre à ses propres besoins, l’hôpital public croule sous les dettes et les universités manquent de moyens, le gouvernement fait le choix d’allouer des fonds importants pour des réparations aux anciennes colonies. L’État semble avoir choisit de ponctionner 41,2% du revenu des grandes entreprises… pour les redistribuer hors du territoire national.
Le silence de l’Élysée à ce sujet est, en soi, une stratégie calculée pour éviter un débat public. Mais cela ne peut que le repousser, tant les besoins intérieurs sont criants et qu’il sera difficile de cacher ce jeu de passe-passe de trésorerie au moment où on demande aux Français plus de sacrifice pour X ou Y.
La ponction sur les grandes entreprises
Selon le budget, la France va instaurer une taxe «temporaire» sur 440 grandes entreprises, notamment celles dont le chiffre d’affaires dépasse 1 milliard d’euros par an. Cette mesure, bien qu’affichée comme temporaire, est susceptible de devenir une norme, à moins que des révisions budgétaires ne soient faites. Ce fonds est destiné à financer les réparations dans le cadre d’un projet plus large qui inclut des projets d’infrastructure en Afrique francophone, des programmes mémoriels (comme des musées et des archives), ainsi qu’une restitution d’objets culturels.
Le montant du fonds est estimé entre 3 et 4 milliards d’euros pour 2026, un chiffre qui pourrait sembler insignifiant au regard des réparations demandées par certaines anciennes colonies, mais qui reste un pas majeur dans un contexte de gestion budgétaire tendu.
Les arbitrages budgétaires : ce qu’on sacrifie vs ce qu’on finance
Une analyse approfondie du budget révèle les mesures envisagées ou déjà en cours et met en lumière les sacrifices consentis par la France pour financer ces réparations :
– Nouvelle taxe «temporaire» sur 440 grandes entreprises (chiffre d’affaires > 1 Md€/an).
– Hausse des taxes sur les billets d’avion, surtout les longs-courriers.
– Coupes budgétaires dans les collectivités locales, la santé des migrants sans-papiers, l’enseignement supérieur, la recherche et la culture.
Ainsi, le budget révèle des choix douloureux :
Ce qu’on coupe :
– 15% de budget en moins pour les collectivités locales : cette réduction affecte directement les services publics locaux, ce qui pourrait entraîner une dégradation des infrastructures de proximité.
– Suppression des soins gratuits pour les sans-papiers : cela pourrait entraîner une crise sanitaire, notamment dans les zones les plus vulnérables de la société française.
– Baisse de 22% des crédits à la recherche fondamentale : cela signifie un ralentissement dans le financement de projets scientifiques importants, nuisant à l’innovation et à la compétitivité à long terme de la France.
Ce qu’on finance :
– Un fonds spécial «réparations» estimé à 3-4 milliards € pour 2026 qui servira à financer les projets mémoriels et les infrastructures dans les anciennes colonies.
– Des projets d’infrastructure en Afrique francophone.
– La restitution d’archives et la mise en place de musées mémoriels dans les pays concernés, ce qui permettrait une reconnaissance officielle des atrocités commises durant la période coloniale.
«On rogne sur l’avenir de la France pour solder le passé», dénonce un haut fonctionnaire du Trésor sous couvert d’anonymat.
L’exemple de Thiaroye
La mention des excuses à Thiaroye n’est pas anodine. Ce massacre de tirailleurs sénégalais en 1944 par l’armée française sert désormais de référence dans les discussions et négociations secrètes sur les réparations avec Dakar. Selon nos informations, chaque geste mémoriel (comme la restitution d’archives ou les excuses officielles) serait désormais assorti d’une contrepartie financière. Une logique de «réparations différées» qui pourrait créer un précédent pour d’autres anciennes colonies.
Les autorités françaises reconnaissent lentement leur responsabilité dans cet événement tragique, mais selon certaines sources, chaque geste mémoriel, comme des excuses officielles ou la restitution d’archives, serait désormais associé à une contrepartie financière. Cette logique de «réparations différées» pourrait potentiellement créer un précédent pour d’autres anciennes colonies.
Comme le souligne l’historien Mamadou Diouf, professeur à l’Université de Columbia, et président du comité de commémoration du massacre de Thiaroye, dans plusieurs entretiens avec le journal Le Monde Afrique en 2023 et 2024 : «Les réparations ne doivent pas seulement être financières, mais symboliques. C’est un processus lent et difficile, mais nécessaire pour tourner la page de l’histoire».1
«Durant des décennies, la France a entravé la mémoire de ce massacre et exproprié les Africains de cette histoire. Thiaroye est une tache morale indélébile que l’ancien colonisateur a longtemps tenté de dissimuler, en interdisant, par exemple, la diffusion du film d’Ousmane Sembène [Camp de Thiaroye, tourné en 1988], ou en niant les faits».[1]
«Ni les autorités sénégalaises, ni le comité ne sont mus par une lutte contre la France, mais par une volonté très forte d’éclairer les faits et de produire un récit historique le moins contestable possible».[1]
Le silence calculé de l’Élysée : stratégie ou embarras ?
Pourquoi tant de discrétion ? Trois raisons possibles :
– Éviter un afflux de demandes (14 pays africains suivent le dossier).
– Ne pas braquer l’opinion publique avant les élections.
– Masquer l’improvisation du dispositif.
«Macron veut son héritage post-colonial, mais sans vague politique», analyse un conseiller de l’hôtel de Brienne, ministère de la Défense à Paris. Le calendrier parlerait de lui-même : les premières annonces ont été faites (discrètement) juste après les européennes de 2024.
Si l’Union Africaine prend l’initiative, la France reste discrète
Aucune réelle trace officielle dans le budget 2025 ou même les prévisions des débats budgétaires pour 2026.
Maintenant, quand tout cela a été dit, il nous faut aussi noter qu’il apparaît que le budget de l’État français pour 2025 ne contient pas de dispositions spécifiques allouées aux «réparations liées à la colonisation». Les informations disponibles indiquent que les discussions sur les réparations se concentrent principalement au niveau international, notamment au sein de l’Union africaine.
En effet, le 15 février 2025, l’Union africaine a adopté une résolution intitulée «Justice pour les Africains et les personnes d’origine africaine à travers les réparations», désignant l’année 2025 comme l’«Année des réparations». Mais si cette initiative met l’accent sur la reconnaissance historique, les réparations financières, la restitution des terres et la préservation culturelle, en ce qui concerne le gouvernement français, bien qu’il reconnaisse les injustices du passé colonial, aucune mesure budgétaire spécifique n’a été identifiée dans le budget 2025 concernant des réparations financières directes aux pays ou aux communautés affectées. Les discussions actuelles se concentrent davantage sur la reconnaissance historique, l’éducation et la préservation de la mémoire.
Notre conclusion
Si ces informations se confirment, la France deviendrait le premier pays européen à indemniser ouvertement ses ex-colonies. Pour l’instant, les autorités françaises restent muettes, mais le budget 2025 semble déjà tout dire.
Entre justice historique et réalisme budgétaire, la France invente-t-elle un nouveau modèle de relations Nord-Sud ou creuse-t-elle son propre déficit ? La réponse en 2026, quand les premiers chèques pourraient être encaissés. En attendant, il sera bien difficile de faire passer la pilule aux Français quand au même moment, les services publics se dégradent avec toujours plus de ponction fiscale, toujours plus d’argent pour l’État mais moins de retour via les services publics dont les plus fondamentaux que sont la santé et l’éducation.
Et surtout plus questions fondamentales : si réparation il y a, est-ce que ces fonds seront utiliser conjointement ou à la discrétion des receveurs ? Es-ce que ces fonds entreront dans le cadre d’un véritable nouveau partenariat qui sera l’acte de décès de la françafrique intégré et accepté par Paris ? Est-ce que ces fonds serviront véritablement au développement économique des pays africains permettant alors en même temps de régler les problèmes migratoires qui enveniment les rapports entre la France et l’Afrique ?
Pour de nouveaux rapports sains entre la France et les pays africains, tout doit être mis sur la table. Mais si en Afrique, on a conscience de devoir reprendre et de défendre sa souveraineté, quand est-il des «élites» françaises à l’heure actuelle ? Entre masochisme national en politique intérieure et relent néocolonial de la Françafrique exacerbé par la conscience de la déchéance de la position de l’Europe dans le cadre de la reconfiguration géopolitique du monde que nous vivons actuellement, il semble que du côté de Paris, on s’arc-boute sur le logiciel «occidental» du siècle dernier.
Source originale : docs.google
Note: Mamadou Diouf : «L’histoire impériale ne peut plus être énoncée exclusivement par la France» – https://www.lemonde.fr/2024/11/11/mamadou-diouf-l-histoire-imperiale-ne-peut-plus-etre-enoncee-exclusivement-par-la-france