F.A. Hayek et le problème de la connaissance : critique du socialisme et de l’interventionnisme
Source : ericverhaeghe.substack.com – 20 octobre 2025 – Eric Verhaeghe
Abonnez-vous au canal Telegram Strategika pour ne rien rater de notre actualité
Pour nous soutenir commandez les livres Strategika : “Globalisme et dépopulation” , « La guerre des USA contre l’Europe » et « Société ouverte contre Eurasie »
L’une des critiques les plus profondes et les plus durables du socialisme au XXe siècle ne fut pas d’ordre moral ou politique, mais épistémologique. Elle ne portait pas principalement sur les intentions des planificateurs, mais sur les limites fondamentales de la connaissance humaine face à la complexité de l’ordre économique. Cette critique, portée à sa forme la plus achevée par l’économiste et philosophe Friedrich August von Hayek (1899-1992), figure majeure de l’École autrichienne d’économie, a radicalement transformé les termes du débat sur la viabilité d’une économie centralement planifiée. Pour comprendre la portée de la contribution de Hayek, il est essentiel de la replacer dans le contexte intellectuel de l’époque, marqué par le “Débat sur le calcul socialiste”.
1. Le défi initial de Ludwig von Mises : l’impossibilité du calcul économique
Au début des années 1920, alors que le socialisme gagnait en influence en Europe, notamment avec l’exemple de l’Union Soviétique, l’économiste autrichien Ludwig von Mises lança un défi fondamental aux partisans de la planification centrale. Dans son article de 1920, “Le calcul économique en communauté socialiste”, Mises soutenait que la planification économique rationnelle était une impossibilité logique dans un système socialiste.
L’argument de Mises repose sur une chaîne causale rigoureuse. Premièrement, dans un système où les moyens de production (usines, machines, matières premières) sont la propriété collective de l’État, il ne peut exister de marché pour ces biens de production. Deuxièmement, sans marché, il n’y a pas de véritable processus d’échange entre des propriétaires concurrents, et donc aucune formation de prix monétaires pour ces biens. Troisièmement, sans prix de marché, les planificateurs centraux sont privés de l’outil indispensable au calcul économique rationnel. Les prix, en effet, ne sont pas de simples étiquettes ; ils sont des condensés d’information sur la rareté relative des ressources et l’intensité des besoins des consommateurs. Ils permettent de comparer la valeur de biens et de services radicalement hétérogènes — une tonne d’acier, une heure de travail d’un ingénieur, un kilowatt-heure d’électricité.
Sans ce dénominateur commun, le planificateur est incapable de déterminer si un projet donné est un usage judicieux ou un gaspillage de ressources rares. Est-il plus efficace de construire un pont en acier ou en béton? Faut-il produire du vin ou de l’huile? Sans prix pour les facteurs de production, ces questions ne peuvent recevoir de réponse rationnelle. Le planificateur peut connaître toutes les options techniques, mais il lui manque le critère de la viabilité économique. La planification socialiste, concluait Mises, n’est pas une économie du tout ; c’est un “tâtonnement dans le noir” (groping about in the dark), un système condamné à l’inefficacité et au chaos.
2. Le tournant épistémologique de Hayek : le véritable problème est la connaissance
Bien que disciple et allié de Mises, Hayek perçut que l’argument du calcul, aussi puissant soit-il, ne suffisait pas. En réponse à Mises, des économistes socialistes comme Oskar Lange et Fred Taylor proposèrent des modèles de “socialisme de marché” où un Bureau Central de Planification pourrait “simuler” le marché en fixant des prix par essais et erreurs, ajustant ces prix jusqu’à ce que l’offre égale la demande. Ils soutenaient qu’une fois ces prix “d’équilibre” trouvés, le calcul économique redeviendrait possible.
C’est ici que Hayek opéra un déplacement décisif du débat. Il comprit que le véritable obstacle n’était pas la capacité de calculer une fois les données connues, mais l’impossibilité fondamentale de rassembler ces données en premier lieu. Le problème n’était pas d’ordre logique, mais épistémologique : il concernait la nature même de la connaissance nécessaire au fonctionnement d’une économie complexe.
Dans son article séminal de 1945, “L’utilisation de la connaissance dans la société” (”The Use of Knowledge in Society”), considéré comme l’un des textes les plus importants de la science économique du XXe siècle, Hayek expose son argument central. Le problème économique fondamental d’une société, soutient-il, n’est pas simplement un problème d’allocation de ressources “données”. Si toutes les informations pertinentes étaient disponibles pour un seul esprit, le problème serait purement logique. Or, le point crucial est que les “données” ne sont jamais “données” dans leur totalité à un seul esprit. La connaissance pertinente pour l’ordre économique est intrinsèquement dispersée, fragmentée et souvent contradictoire, répartie dans l’esprit de millions d’individus. Le véritable problème économique est donc de savoir comment utiliser au mieux cette connaissance dispersée.
L’argument de Hayek est ainsi plus fondamental que celui de Mises. Il ne se contente pas de dire “sans prix, on ne peut pas calculer”, il demande : “d’où viendrait l’information pour former ces prix?”. Cette question révèle que la proposition du “socialisme de marché” repose sur une illusion. Le Bureau de Planification ne peut pas “trouver” les bons prix par tâtonnement, car il ne peut jamais avoir accès à l’infinie multitude d’informations locales, changeantes et non quantifiables que ces prix sont censés refléter. En déplaçant le débat sur le terrain de la connaissance, Hayek a non seulement renforcé la critique du socialisme, mais a également jeté les bases d’une nouvelle compréhension du marché lui-même.



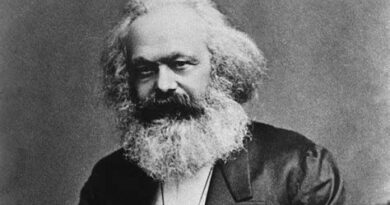

À toutes fins utiles, précisons que le Socialisme moderne trouve ses origines dans un mouvement féministe incompris à son époque, le « Saint-Simonisme », courant idéologique reposant à l’origine sur la doctrine socio-économique et politique de Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon (1760-1825). C’est le Communisme des premiers Chrétiens (de Saint-Jean) que ce rénovateur moderne proposa comme un exemple à imiter. Ce magnifique mouvement de réveil féministe dût subir la persécution, comme la subissent tous les grands mouvements de la pensée. Ce mouvement fut repris par Charles Fourier (1772-1837), dans la Phalange, et se fondit dans le fouriérisme qui le modifia, le masculinisa et en fît « le socialisme ».
Là encore, nous voyons l’avortement d’un mouvement féministe, et sa transformation au profit de l’homme, comme l’avaient été, 50 ans auparavant, le grand mouvement de la Révolution Française, et 1.500 ans avant celle-ci, le premier Christianisme.
NB : Les féministes les plus militants et les plus sincères que les temps modernes aient connus sont, incontestablement, les Saint-Simoniens.
Ceux-là prétendaient remettre la femme à la place que lui a donnée la Nature et lui prodiguaient, sans marchander, leurs éloges et leurs hommages.
Leur apostolat était l’appel de la femme.
Saint-Simon disait : « Ma parole est celle de l’homme précurseur de la femme. Messie de son sexe, qui doit le sauver de l’esclavage qui est la prostitution, j’ai à préparer l’affranchissement des femmes par les femmes »
Cette Femme-Messie, conjointement avec l’homme, devait composer le prêtre, c’est-à-dire « le couple sacerdotal, dépositaire des pouvoirs de la société, et dont le rôle, dans l’avenir, consistait à diriger, humaniser les appétits, facilitant l’union des êtres à affections profondes. »
Jean Journet, l’un d’eux, écrivait : « Alors la femme souveraine, A l’encontre des méchants, Doit affranchir l’espèce humaine D’un martyr de six mille ans. »
Les Saint-Simoniens avaient la prescience du sexualisme, c’est-à-dire de la loi des sexes et de ses conséquences différentes dans l’un et dans l’autre. C’est ce qui faisait leur supériorité sur les hommes qui ne voyaient que le côté politique ou social de la question. Ils parlaient déjà du « secret de la maternité », de son sacerdoce futur, de son élévation.
Mais le public ne les comprenait pas, les femmes surtout, encore imbues des préjugés dont leur éducation est faite, leur faisaient opposition. Mme Cécile Fournel fut la première à condamner cette grande doctrine libératrice de la femme.
A l’enterrement de Talabot, Barrault rappela que dans les premières années de sa jeunesse, Talabot s’était fait remarquer par « une grande passion pour les femmes », ce qui fit sourire certains assistants, ceux qui aiment les malentendus.
« Pauvres femmes, s’écria alors Barrault, je parle d’un homme qui vous rendit un culte et l’on rit. Ah ! Sans doute, les temps sont passés où l’homme vous entourait d’un hommage chevaleresque et les temps ne sont pas encore arrivés où il pourra, sans vous dégrader, et sans se dégrader lui-même, témoigner de votre puissance. »
Dans les banquets qui réunissaient fraternellement les disciples de Saint-Simon, la place d’honneur était occupée par un fauteuil vide, celui de la Femme, l’absente, celle qu’on attendait, celle qui allait naître pour libérer son sexe et sauver l’homme de la dégénérescence et de la folie.
Ils attendaient la femme, et annonçaient sa venue pour des temps prochains, et Enfantin, reconnaissant l’impuissance de l’homme, disait : « Il n’y aura de science définitive que lorsque la femme aura parlé. »
Prosper Enfantin a dit ces mots que l’on a gravé sur sa tombe : « L’âge d’or n’est pas dans le passé, il est dans l’avenir. » (Comprendre Âge d’Or d’un nouveau Cycle, du Manvantara qui vient)
Les principaux disciples de Saint-Simon étaient Bazard, Rodriguez et Enfantin.
Le 27 août 1832 eut lieu le procès des Saint-Simoniens.
Tous descendirent alors des hauteurs de Ménilmontant où ils avaient établi leur retraite et, dans l’élégant costume qui avait été dessiné par Raymond Bonheur, (père de Rosa Bonheur), ils traversèrent, la tête haute, les bras croisés sur la poitrine, une foule considérable, massée dans les rues pour les voir passer.
On accusait cette haute morale… d’immoralité.
Mais leur mouvement ne périt pas. Fourier le reprit, dans la Phalange, et il se fondit dans le fouriérisme qui le modifia, le masculinisa et en fît « le socialisme ».
Sous cette forme, il devait grandir vite dans les esprits.
Ce sont ces transformations de l’idée pure qui stérilisent les grandes impulsions données de temps en temps par les femmes, ou par les féministes.
Il se trouve toujours un homme plus audacieux que les autres, qui adopte l’idée lancée et la dénature.
Là est le secret de l’avortement de la Révolution française.
Là est le secret, aussi, de la stérilité du socialisme moderne.
Mais l’idée dénaturée renaît sous une nouvelle forme.
C’est ainsi que le Saint-Simonisme reparut dans le Positivisme d’Auguste Conte ; doctrine qui met encore, au sommet, la femme, cette fois personnifiée dans Clothilde de Vaux.
Stuart Mill avait 26 ans quand eut lieu le procès des Saint-Simoniens. Il s’était occupé activement de cette doctrine, qui l’avait profondément impressionné.
Stuart Mill, dans une lettre adressée à M. Gustave d’Eichtal dit :
« C’est un noble spectacle, que vous donnez au monde d’un groupe d’hommes debout et lui tenant la tête… La lecture du Globe m’a beaucoup rapproché de vos opinions. Pas un de ces articles qui n’ait remué en moi quelque chose, qui ne m’ait amélioré en quelque point. Si l’heure était venue pour l’Angleterre, s’il n’était pas aussi vain de chercher ici actuellement un auditoire pour des vues organiques, qu’il eût été pour Saint-Simon dans le feu de la Révolution, je ne sais si je ne renoncerais pas à toute chose pour devenir, non l’un de vous, mais comme vous. »
Lien : https://livresdefemmeslivresdeverites.blogspot.com/2017/07/ceuxquiviventcesontceuxquiluttent.html