Primordialité de la tradition celtique
Source : 27 octobre 2025 – Phillipe Baillet
Abonnez-vous au canal Telegram Strategika pour ne rien rater de notre actualité
Pour nous soutenir commandez les livres Strategika : “Globalisme et dépopulation” , « La guerre des USA contre l’Europe » et « Société ouverte contre Eurasie »
Article de Phillipe Baillet, revue Totalité n°11, 1980
En dépit du pullulement grandissant des représentants de ce qu’Evola a justement appelé « la race de l’homme fuyant », c’est-à-dire d’individus incapables, dans n’importe quel domaine, de poursuivre une recherche persévérante et sérieuse, on trouve encore dans notre pays des hommes libres, discrets, insouciants des modes idéologiques et culturelles, et dont les travaux, touchant des sujets assez spécialisés, n’ont pas la diffusion qu’ils méritent et restent même parfois inconnus de ceux à qui, pourtant, ils sont prioritairement destinés. Tel est le cas des recherches et des études sur la tradition celtique entreprises depuis maintenant plus de trente ans par Françoise Le Roux et Christian Guyonvarc’h. Des recherches dont les premiers résultats furent d’abord publiés dans la revue Ogam Celticum et dont les conclusions viennent de faire l’objet de plusieurs livres du plus haut intérêt. Deux d’entre eux méritent plus particulièrement d’être signalés : La civilisation celtique, sorte de manuel introductif à la question, et Les Druides, ouvrage à propos duquel il n’est pas exagéré de dire qu’il représente la somme la plus complète dont on puisse disposer en Europe sur le sacerdoce celtique.

Longtemps considéré comme une espèce de continent englouti à jamais inaccessible, l’univers de la tradition celtique est encore trop souvent la pâture de pseudo-spécialistes et de charlatans qui ne font qu’attribuer aux anciens Celtes leurs propres élucubrations. De sorte que toute étude rigoureuse sur la question se doit d’abord de faire place nette des interprétations irrecevables et de définir clairement sa méthodologie. Car il est plus facile d’évoquer le mystère que d’aider à le dissiper et, quand les documents font défaut sur un aussi vaste sujet, il est plus tentant de présenter des théories que des faits. (…)
En l’absence de nombreux documents écrits, la seule manière d’interpréter correctement la tradition celtique et son incarnation la plus haute dans la société, à savoir le druide, c’est d’étudier la légende et le mythe. Les auteurs ont donc voulu montrer que le druide mythique est la meilleure approximation possible du druide historique, parce que, que ce soit dans l’histoire ou le mythe, les hiérarchies et les spécialisations sont identiques. La légende celtique transpose dans le mythe la réalité d’une structure sociale et religieuse. Et, inversement, quel prêtre ne se donnerait pas pour idéal de ressembler au dieu qu’il honore ? Ce n’est pas, en conclusion, la société qui secrète la religion, c’est la religion qui détermine la forme de société. (…)
Le druide : indistinction et souveraineté
Au sujet des druides, les auteurs affirment d’abord leur appartenance au plus lointain passé indo-européen :
« … le nom des druides est spécial au monde celtique, explicable par les seules langues celtiques avec des éléments constitutifs indo-européens : la forme gauloise druides (singulier druis), utilisée par César dans le De Bello Gallico, de même que l’irlandais druid, remontent à un prototype dru-wid-es qui contient la même racine que le latin videre (“voir”), le gotique witan, l’allemand wissen (“savoir”). Il est donc vain, par définition étymologique aussi, de prêter aux druides une origine pré-indo-européenne ou de supposer que le “druidisme” se serait constitué à la seule époque où il est attesté historiquement. »
La primordialité du sacerdoce celtique n’a d’égale que celle des brahmanes de l’Inde. Le druide jouit, comme ces derniers, d’un prestige extraordinaire. Aucune interdiction ou limitation ne l’entrave : c’est au contraire lui qui a le pouvoir de lier et de délier. Selon les auteurs,
« la structure sacerdotale celtique est assez ancienne, avec ses druides qui ont droit au sacerdoce et à la guerre (mais le guerrier n’a pas droit au sacerdoce), pour qu’on y voie le souvenir idéal d’un état d’indistinction primordiale, celui d’un état édénique de la société, composée d’hommes intelligents et sages… ».
Dans la société celtique, en effet, il y a primauté de l’autorité spirituelle sur le pouvoir temporel : le roi commande aux hommes, mais le druide, en tant qu’administrateur du sacré par excellence, commande au roi ; personne ne parle avant le roi, mais le roi ne parle pas avant le druide.
Autres preuves du caractère original de la tradition celtique : l’enseignement des druides est oral et direct, analogue à celui des gurus de l’Inde et des soufis de l’Islam. Mais le druidicat n’est pas héréditaire : l’indistinction « par le bas » sur l’origine sociale du candidat est ici le reflet inversé de l’indistinction « par le haut » qui sera sienne au terme de l’enseignement..
On trouve aussi dans la tradition celtique des symboles comme le saumon — le poisson qui remonte à la source — et l’oursin fossile, à rapprocher de l’Hiranyagarbha hindou représentant l’œuf cosmique : traits qui attestent la présence d’une doctrine purement métaphysique. Un druide mythique s’appelle Mog Ruith, c’est-à-dire « Serviteur de la Roue », ce qui reconduit obligatoirement à une correspondance avec le Cakravartî oriental.
Chez les Celtes, la souveraineté temporelle, l’intermédiaire indispensable entre les hommes et les druides — ceux-ci étant, pour leur part, plus proches des dieux que des hommes — est d’essence masculine et se trouve incarnée par le roi. Cependant, la Souveraineté authentique est personnifiée par une femme, non parce que les Celtes auraient adoré une déesse-mère et appartenu ainsi à une civilisation de type « gynécocratique », mais bien parce que la Souveraineté, analogue à la terre, se renouvelle constamment et n’est en réalité souillée par rien.
Suivant la définition de la reine Medb, le roi doit être « sans peur, sans jalousie, sans avarice », cependant que la reine elle-même n’est jamais « sans un homme dans l’ombre d’un autre », car si le roi est temporel et susceptible d’être remplacé, la Souveraineté, toujours jeune et toujours vierge, à la beauté tentatrice et resplendissante, est aussi éternelle que le principe qu’elle représente et qu’elle incarne.
Parmi les autres traits vraiment archaïques de l’univers celtique, il faut ajouter que les Celtes, rebelles au travail de la pierre, n’ont connu d’autre lieu sacré que la nature, perçue par eux comme une théophanie perpétuelle. Forêt et temple sont des notions équivalentes pour les Celtes. La forêt est le lieu sacerdotal par excellence. Il y a aussi la mesure du temps, particulièrement significative pour peu qu’on y réfléchisse : l’Irlande comptait de même par nuits : aidche Samna « la nuit de Samain », spécifient parfois les textes ; wythnos « huit nuits », pymthegnos « quinze nuits », dit-on en gallois, pour désigner la semaine et la quinzaine, tandis qu’en breton antronoz « lendemain » est littéralement « au-delà de la nuit ». Cette conception explique pourquoi, dans le calendrier, la saison sombre est le commencement de l’année. Là encore, y a-t-il contradiction entre cette façon de compter et les légendes et mythes remplis de héros solaires ? Non, cela se justifie sur le plan métaphysique : « Les Celtes sont les enfants du dieu de la nuit, car c’est la nuit qui donne naissance au jour comme l’Être est issu du Non-Être. »
À l’instar de toute civilisation traditionnelle complète, la civilisation celtique exprime dans tous les domaines une nostalgie des origines, et, comme dans la tradition hindoue, le druide y représente parfaitement la voie du sannyâsi, du « pauvre véritable », le point de vue jnâna kânda propre à la via remotionis de ceux qui ne sont plus sous la loi : là, le silence est supérieur à la parole, le sommeil profond de la Nuit à l’état de veille du Jour, le Non-Être à l’Être, la non-manifestation à toute détermination. (…)
Le seigneur perpétuel et le centre du monde
Un autre thème traditionnel dont on trouve des traces très nettes dans la tradition celtique, c’est celui du roi du monde. La Gaule elle-même nous a légué à ce sujet un héritage intéressant :
« La tradition du roi du monde, qui est aussi un roi perpétuel, n’est pas attestée en Gaule dans un individu mais dans un nom ethnique, celui des Bituriges, qui se décompose en bitu- (à la fois “monde” et “âge”) et riges, pluriel de rex (“roi”). Les Bituriges, dont le nom a produit en français, selon la place de l’accent tonique, Berry (Bituriges) et Bourges (Biturigibus au datif pluriel latin), sont bien au centre géographique de la Gaule, et ils sont voisins du locus consecratus, lieu consacré qui passe par le centre de la Gaule, d’après César, chez les Carnutes, et où les druides tenaient leur assemblée générale. »
On trouve encore d’autres échos de cette conception dans le nom latin de Milan (Mediolanum), fondée par les Gaulois, et dans la division quaternaire de l’Irlande : quatre provinces qui entourent la province centrale de Mide (Meath), « milieu », formée par le prélèvement d’une parcelle de territoire sur les autres provinces, et où est sise la capitale, Tara.
Il serait d’ailleurs intéressant d’étudier de plus près l’importance du quaternaire chez les Celtes : quatre fêtes (Imbolc, fête de lustration et de fécondité à la fin de l’hiver ; Beltaine, fête sacerdotale du commencement de l’été ; Lugnasad, fête politique du bon gouvernement ; Samain, période close où le sid, le surnaturel, envahit le monde des hommes) ; quatre attributs symbolisant la souveraineté et évoquant l’habitat primitif des dieux :
« C’est de Falias que fut apportée la Pierre de Fal qui était à Tara. Elle criait sous chaque roi qui prenait l’Irlande. — C’est de Gorias que fut apportée la lance qu’avait Lug. Aucune bataille n’était gagnée contre elle ou contre celui qui l’avait dans la main. — C’est de Findias que fut apportée l’épée de Nuada. Personne ne lui échappait quand elle était tirée du fourreau de la Bodb et on ne lui résistait pas. — C’est de Murias que fut apporté le chaudron du Dagda. Aucune troupe ne le quittait insatisfaite. »
(…) Ces deux ouvrages, en résumé, évoquent de manière si juste et si complète une tradition morte, mais qui fut d’un niveau très élevé, qu’on en arrive presque à penser avec leurs auteurs que « les druides ont été les détenteurs de la seule forme de tradition que l’Occident ait jamais connue ».





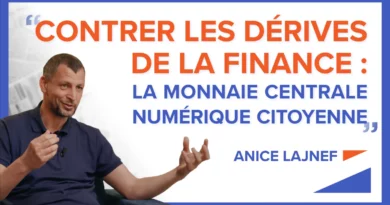

« Le retour de l’occident à la civilisation passe par l’abandon de l’actuelle « Société de l’avoir » pour rendre à la « Société de l’être », parfaitement incarnée par la tradition culturelle française aujourd’hui malheureusement abandonnée, la prééminence qu’elle n’aurait jamais dû perdre. » (Valérie Bugault)
En l’an 52, César vit la Gaule tout entière soumise à sa puissance. C’est ainsi que, affaiblie par ses discordes intestines, elle ne put pas échapper à la domination étrangère qui se partagea ses dépouilles, ne trouvant plus en elle qu’un cadavre sans force.
C’est alors qu’on dut se souvenir, mais trop tard, des paroles de Valérie… Velléda, prêtresse et prophétesse gauloise, qui disait aux Gaulois : « Est-ce là le reste de cette nation qui donnait des Lois au monde ? Où sont les États florissants de la Gaule, ce Conseil des Femmes auquel se soumit le grand Annibal ? Où sont ses Druides et ses Druidesses qui élevaient dans leurs collèges sacrés une nombreuse jeunesse ? Proscrits par les tyrans, à peine quelques-uns d’entre eux vivent inconnus dans des antres sauvages. Velléda, une simple Druidesse, voilà donc tout ce qui vous reste aujourd’hui. »
Il existe deux courants dans l’opinion des intellectuels : l’un qui prétend que la civilisation est venue des Latins ; l’autre qui affirme qu’elle est venue des Celtes.
Les Latins appuient leur opinion sur le droit romain qui a instauré la puissance paternelle, et proclamé la déchéance de la Femme, et sur la littérature latine qui a sanctionné cet état de choses.
Les Celtiques appuient la leur sur le droit naturel, le règne de la raison représenté dans sa plus haute manifestation par la Femme, la Déesse-Mère, qui régnait dans les Républiques Celtiques.
Donc, le conflit représente la lutte de sexes, et la résume.
Contrairement à ce que croient les Latins, la primitive civilisation prit naissance dans le pays qui fut le berceau des Celtes, et qui est compris entre la Manche et le Rhin. C’est là que s’est constitué le fond de la race celtique ; « Fixés sur leur base séculaire, dit M. Cailleux, ils occupent aujourd’hui les mêmes positions où l’histoire les a trouvés, la science ne peut sonder leur origine ni prévoir leur décadence. »
La race celtique a affirmé la supériorité de sa nature par son empire sur le monde entier où elle a porté la civilisation dont elle possède en elle les éléments, c’est-à-dire la supériorité de l’esprit, la bonté et l’audace. Il existe en elle un principe de vie, une action secrète et puissante qui l’anime en tous ses mouvements et lui donne un empire qui n’appartient qu’à elle.
Ce sont ces caractères qui lui ont donné une si grande puissance de développement. Elle n’a pas reçu la civilisation comme les Grecs et les Romains, elle l’a créée.
La race celtique fut vaincue par les Romains, qui semèrent partout le désordre et l’impuissance. Leur séjour dans la Gaule fut une éclipse dans la vieille civilisation ; il laissa comme trace de son passage les luttes féodales, basées sur l’ambition et le despotisme de l’homme qui ne reconnaît plus aucune loi morale, puis les dissensions autour du principe de la monarchie dynastique, imitation de l’empire romain, qui firent régner pendant quinze siècles la barbarie latine sur le sol où s’étaient développées jadis, dans le calme et la sécurité, les Républiques Celtiques.
Sur quoi prétend-on appuyer la culture latine ?
Sur la philosophie grecque qui avait renversé l’Ecole Pythagoricienne, dernier foyer de haute culture scientifique, auquel on substitua une série de sophismes qui aboutirent aux erreurs modernes. (Voir l’article sur La Grèce antique)
Les Romains, héritiers et continuateurs des Grecs, allèrent plus loin encore, et de tout ce fatras incohérent firent le dogme surnaturel et superstitieux qui a envahi le monde. (Voir l’article sur Les origines et l’histoire du Christianisme)
Les principes de l’empire romain furent le despotisme de la puissance impériale, appuyé sur la force et sur le code romain qui donne à l’homme le droit de vie et de mort sur l’esclave, sur la femme et sur l’enfant.
Ce sont ces principes-là que l’impérialisme laïc ou religieux représente aujourd’hui ; c’est lui qui continue Rome, ce n’est pas la France républicaine qui est restée celtique au fond. Il ne lui manque plus que de rendre à la Femme la place que ses aïeux lui donnaient pour être revenue à la civilisation des anciens Celtes.
C’est contre ce que Rome nous a légué de despotisme et d’erreurs que les civilisés actuels doivent se liguer, ce n’est pas pour faire renaître la culture latine qui n’a été qu’une forme de la décadence morale. C’est sur les ruines définitives du droit romain que s’élèvera le monde nouveau, basé sur le droit naturel.
Si nous jetons les yeux autour de nous, nous voyons que, actuellement, les révolutionnaires de la pensée qui veulent plus de vérité et plus de justice sont presque toujours ceux qui n’ont pas fait leurs humanités, c’est-à-dire ceux qui n’ont pas reçu l’empreinte fatale de la culture latine qui atrophie l’esprit et développe l’orgueil de l’homme ; ceux-là sont les continuateurs des Celtes-Gaulois, ils cherchent en avant un progrès qui n’est qu’un retour vers la civilisation détruite par les Romains.
Pendant que les Latins brûlaient les Livres sibyllins, les Druidesses qui enseignaient dans leurs collèges formaient l’âme gauloise.
NB : « Il est d’ailleurs probable que ce nom des Celtes, comme celui des Chaldéens qui lui est identique, n’était pas originairement celui d’un peuple particulier, mais celui d’une caste sacerdotale, exerçant l’autorité spirituelle chez différents peuples. » (René Guénon, Symboles de la Science sacrée,Chap.XXIV, Le Sanglier et l’Ourse, note de bas de page)
Lien : https://livresdefemmeslivresdeverites.blogspot.com/2017/07/celtesetlatins.html