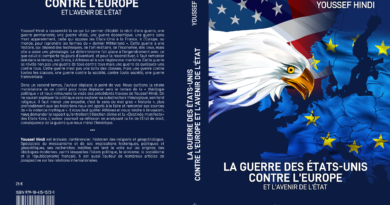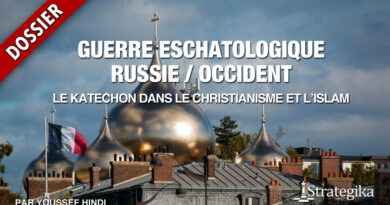Sanctions occidentales, suicide occidental
Par Cyrano de Saint Saëns
Abonnez-vous au canal Telegram Strategika pour ne rien rater de notre actualité
Pour nous soutenir commandez les livres Strategika : “Globalisme et dépopulation” , « La guerre des USA contre l’Europe » et « Société ouverte contre Eurasie »
Cyrano de Saint Saëns est un analyste géopolitique francophone qui possède une longue expérience dans les domaines des relations internationales, des conflits hybrides et de la géopolitique.
Y a-t-il vraiment quelqu’un qui pense que la stratégie économique internationale de Trump ait un quelconque fondement ? Pouvons-nous sérieusement croire qu’il sait ce qu’il fait lorsqu’il décide d’imposer des sanctions à des pays qui, selon lui, nuisent aux intérêts nationaux, pour ensuite constater que ces mesures finissent par affecter les travailleurs américains ?
Les sanctions secondaires sont presque impossibles à faire respecter. Trump aurait dû s’en rendre compte dès son premier mandat, lorsqu’il les a appliquées à la Turquie, à la Chine, à la Corée du Sud et à l’Inde pour les dissuader d’acheter du pétrole iranien. Au départ, elles semblaient efficaces, mais la Chine n’a pas tardé à mettre au point des systèmes alternatifs et des mécanismes de contournement lui permettant de continuer à acheter du pétrole brut à bas prix à Téhéran, tout en donnant l’impression qu’elle ne le faisait pas. Les autres pays ont rapidement suivi le même chemin.
Et aujourd’hui, il semble que Trump n’ait toujours pas appris la leçon. Cependant, le problème ne concerne pas seulement lui : il concerne également l’Union européenne et ses États membres. Tout étudiant en économie peut observer comment l’économie allemande s’effondre à un rythme alarmant ou comment le Royaume-Uni risque de devoir recourir à un gigantesque plan de sauvetage du FMI d’ici un an, en raison du déclin économique lié au financement de la guerre en Ukraine et à l’abandon du pétrole russe à bas prix. Les sanctions contre la Russie ont-elles profité à certains pays occidentaux ? Évidemment pas.
Récemment, les États-Unis ont imposé des sanctions aux géants pétroliers russes Rosneft et Lukoil et à leurs filiales, tandis que l’UE, presque simultanément, a officiellement lancé le 19e paquet de mesures contre Moscou, visant plus de 117 navires appartenant à ce que Bruxelles appelle une « flotte fantôme » russe, c’est-à-dire des navires enregistrés dans différents pays mais considérés comme appartenant directement ou indirectement à la Russie.
À un certain moment, Trump a décidé que l’Inde devait devenir l’exemple flagrant à punir, afin de démontrer au monde qu’il n’est pas possible de rester non aligné et d’obtenir des avantages des deux côtés.
Au début de cette année, il a imposé un droit de douane de 25 % à l’Inde, justifiant cette mesure par ses achats de pétrole russe. Cette mesure a constitué un double coup dur, car elle s’ajoutait à un précédent droit de douane de 25 % introduit à l’occasion du « Liberation Day ». Le président américain a accusé l’Inde et la Chine de contribuer au conflit ukrainien en achetant du pétrole brut russe.
Même des pays comme le Maroc, qui ont continué à acheter du pétrole à Moscou, ont peut-être craint pendant un certain temps d’être les prochaines cibles, mais Rabat n’avait aucune raison de s’inquiéter. Dans un monde désormais multipolaire, ce type de sanctions impulsives à l’américaine semble en effet voué à l’inefficacité. On assiste à une tendance mondiale à la réduction de la dépendance vis-à-vis du dollar, les BRICS émergeant comme un nouveau bloc commercial, et des mesures telles que celles prises à l’encontre de l’Inde risquent concrètement de pousser New Delhi vers d’autres grands partenaires capables de lui offrir de meilleurs armements à moindre coût. Dans le cas de la Chine, en revanche, cela ne fait que renforcer sa stratégie géopolitique et militaire en Orient contre les États-Unis et leurs alliés. Il semble presque que les conseillers de Trump lui aient suggéré que l’Inde était une cible facile, un fruit à portée de main, convaincus que ses dirigeants s’adapteraient rapidement.
Il s’agissait d’une erreur d’appréciation colossale : les sanctions s’avèrent être un boomerang tant pour les États-Unis que pour les gouvernements européens, aujourd’hui contraints d’étudier des mesures fiscales désespérées uniquement pour maintenir les infrastructures publiques en état de fonctionnement.
Les mesures occidentales contre la Russie ont échoué de manière si retentissante qu’on peut supposer que Moscou s’y était préparée bien à l’avance et qu’elle en est même sortie renforcée. Les sanctions n’ont pas réussi à mettre fin à la guerre en Ukraine. Seul un abandon des illusions irréalistes encore entretenues par de nombreux dirigeants occidentaux, selon lesquelles l’économie russe serait en faillite et incapable de soutenir l’effort militaire dans le Donbass, pourrait y parvenir.
L’idée européenne de confisquer les biens russes saisis n’est pas une stratégie, mais le symptôme d’un échec politique à plusieurs niveaux. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Zelensky reste au pouvoir : les fonds occidentaux lui garantissent le minimum indispensable pour alimenter la machine de guerre et maintenir l’appareil en activité, tandis que la loi martiale lui permet de rester président bien au-delà de son mandat légal.
Que diront ces dirigeants lorsque Pokrovsk, ville de l’est de l’Ukraine encerclée par les forces russes, tombera ? Alors que Zelensky y envoie ses forces spéciales pour gagner du temps, la Russie autorise les journalistes étrangers à se rendre sur place et à s’intégrer à son armée, tant Poutine semble convaincu que la chute de cette ville clé est imminente et qu’elle pourrait déclencher un effet domino capable de balayer toute l’armée ukrainienne.