Pour Henri Guillemin, Pompidou et la Banque ont renversé de Gaulle
Source : egaliteetreconciliation.fr – 11 avril 2025 – E&R
Abonnez-vous au canal Telegram Strategika pour ne rien rater de notre actualité
Pour nous soutenir commandez les livres Strategika : “Globalisme et dépopulation” , « La guerre des USA contre l’Europe » et « Société ouverte contre Eurasie »
Le temps, parfois, exhume des choses inattendues. Des cadavres remontent à la surface, qui parlent aux vivants… Dans un autre ordre d’idées, on peut dire qu’en 2016 Fillon a été tué par Macron, l’employé de la Banque, comme Pompidou l’était dans les années 60.
Extrait du portait de Georges Pompidou
À la recherche d’un nouveau challenge, Pompidou entre en 1953 à la banque Rothschild. De nouveau, il se distingue par son aptitude à assimiler de nouvelles compétences. Ayant acquis promptement les connaissances des techniques financières et commerciales, il remet à flot une société spécialisée dans le financement de l’import-export. Au sein de la banque, il s’intéresse davantage au secteur financier qu’au domaine proprement bancaire, séduit par les spéculations intellectuelles qu’exige la finance. Il sait donner à sa société un nouveau capital de confiance, une autre qualité de réflexion, qui ignore le détail, exclue l’accessoire pour se concentrer sur l’essentiel.
Le retour aux affaires de De Gaulle en 1958 lui fait quitter la banque pour six mois. Mais, refusant le portefeuille de ministre des Finances, Pompidou choisit de retrouver la Banque Rothschild. Il y restera jusqu’à sa nomination comme Premier Ministre en 1962. Perçu comme l’homme de la continuité, il est élu président de la République.
On ne peut mieux dire. La collusion État-Rothschild est une tradition française. Pour ceux qui ont fait sa bio, son passage par la direction de la fameuse banque n’est qu’un job comme un autre, prestigieux, certes, mais sans lien avec le politique.
Atteint d’un cancer, il quittera son poste en 1973 non sans avoir laissé au pays la fameuse loi de finances de 1973, qui fait encore couler de l’encre aujourd’hui. Pour les journalistes mainstream, ce n’est pas le point de départ de la dette française vis-à-vis de la Banque (cela inclut les assurances et les grands prêteurs internationaux), non, non.
Cette idée d’une « loi scélérate », source de l’endettement excessif de la France et donc, indirectement, de tous ses maux économiques depuis plus de quarante ans, est fréquemment évoquée par Debout la France, le Rassemblement national, Jacques Cheminade ou François Asselineau, mais aussi par de nombreux blogs d’extrême droite et de gauche radicale. Elle postule que l’Etat pouvait auparavant emprunter à un taux d’intérêt nul auprès de la Banque de France, ce qui lui a été interdit par la loi. (…)
La plupart des critiques se concentrent en réalité sur l’article 25 de la loi du 3 janvier 1973, constitué d’une seule phrase : « Le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l’escompte de la Banque de France. » Pour ses détracteurs, cela implique que l’État ne peut plus créer de monnaie et se trouve donc désormais obligé de se financer auprès des banques privées (dont la banque Rothschild).
À ce propos, Jacques Cheminade avait réagi avec précision à l’article du Monde. Pour lui, ce n’était pas la loi dite de clarification de 1973 qui a déclenché l’endettement de notre pays, mais bien le traité de Maastricht en 1992.
« Dans mon projet présidentiel de 2017, j’ai souligné que c’est la loi du 4 août 1993 qui a mis officiellement fin aux avances de la Banque de France au Trésor. En outre, comme l’indique un schéma du rapport de la Commission des finances du Sénat du 31 mai 2017, les concours de la Banque de France sont passés de 15 % de la dette française en 1978 à 0 % en 1983. Il apparaît donc que le démantèlement des avances de la Banque de France n’a pas été la conséquence de la loi de 1973, mais d’une décision politique, à partir de 1983, entérinée par la loi du 4 août 1993. »
La loi Pompidou de 73 n’est donc pas le déclencheur de la dette française. Justice lui soit rendue. Mais on peut s’interroger sur les événements de Mai 68 qui ont renversé le Général et propulsé Pompidou sur le trône. Les complotistes se jetteront sur l’axe Bendit-Pompidou-Rothschild, après les déclarations du chef de l’État en 1967 sur Israël, sachant ce que les Rothschild y avaient investi depuis un siècle (Edmond commença à acheter des terres en Palestine dès 1882), mais théorie n’est pas preuve.
Aujourd’hui, la passerelle Banque-État est étudiée de près.
Récemment, le secrétaire général de l’Élysée, Alexis Kohler, a lâché son job (de vrai président à la place du comédien en poste) pour aller pantoufler à la SocGen. Rien ne change, en France, sous la Ve. On pourra dire un jour que c’est depuis 60 ans un régime de collusion, de corruption et d’abandon de souveraineté au profit de Bruxelles, c’est-à-dire de l’OTAN et de l’Amérique.

Conclusion : une longue lignée de serviteurs de l’État sont passés par la maison Rothschild. Cela ne veut pas dire qu’ils trahissent l’esprit républicain, surtout s’ils offrent leur compétence à la France. Si Pompidou était un excellent gestionnaire, qui bénéficiait quand même du pic des Trente Glorieuses, on ne peut en dire autant de Macron. Lui a grillé les étapes dans un flou artistique, créant des interrogations ici, des stupéfactions là. Son CV est un kaléidoscope imbitable : le Mozart de la finance est un pipeau intégral. On le voit d’ailleurs à l’état du pays au bout de sept ans de malheurs.




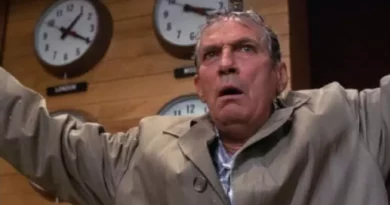
Pompidou et la « Banque » : le petit bout de la lorgnette.
Petit bout de la lorgnette : Arrivé au pouvoir suprême en 1969, après la démission de Charles de Gaulle, Georges Pompidou, ex-employé de la banque Rothschild comme Emmanuel Macron (on constate que le véritable pouvoir n’a guère évolué en 50 ans, ce qui, en définitive, est la seule chose réellement stable dans ce pays), pond la loi du 3 janvier 1973, également appelée « loi Pompidou-Giscard » ou encore « loi Pompidou-Giscard-Rothschild » (reprise, systématisée et aggravée depuis par l’article 123 du TFUE, Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne de 2009), qui modifie les statuts de la Banque de France et donne le coup d’envoi d’une dette qui n’aura de cesse d’augmenter exponentiellement et, ainsi, de vampiriser toutes les richesses nationales produites.
Avant cette loi, quand l’État empruntait de l’argent, il le faisait auprès de la banque de France, qui, lui appartenant, lui prêtait sans intérêt. La loi de 1973, en interdisant à la Banque de France de faire crédit à l’État, condamnait la Nation à se tourner vers des banques privées et à leur payer des intérêts. Ainsi naquit la dette perpétuelle. Aussi, depuis 1974, plus aucun budget de l’état n’a été à l’équilibre.
Aline de Diéguez, dans son ouvrage « Aux sources du chaos mondial actuel », nous rappelle que « Chaque seconde qui passe augmente les intérêts de la dette publique de la France de 2490 € ». Selon les chiffres fournis par Maurice Allais, (1911-2010), prix Nobel d’Économie en 1988, 93% de la dette française est attribuable aux intérêts compensés. En septembre 2011, la dette publique s’élevait à 1 789 milliards d’€ et les intérêts de la dette à plus de 43 milliards d’€.
Au 4ème trimestre 2024, le montant de la dette est de 3 305 milliards d’€ (contre 3 047 milliards d’€ en 2023), et c’est 58 milliards d’€ (contre 55 milliards d’€ en 2023) que les contribuables français auront versé aux banquiers privés au titre des seuls intérêts de la dette pour 2024.
Gros bout de la lorgnette : À partir de juillet 1944 (accords de Bretton Woods), le dollar américain devient à la fois monnaie nationale et monnaie mondiale de référence. Cependant, les « puissances d’argent » de la City de Londres soutenaient une autre option : celle d’une monnaie mondiale conçue comme un « panier » de monnaies.
En 1967 toute la stabilité du Système Monétaire International basé sur les accords de Bretton Woods allait être vivement secouée en raison, en grande partie, de l’importante dévaluation de la Livre Sterling qui faisait suite à l’effondrement de l’économie britannique lié à « l’histoire secrète du pétrole ».
Rappelons qu’en 1967, le Président de la République Française, Charles de Gaulle, déclarait : « La guerre du Vietnam et celle du Proche-Orient sont étroitement liées ». On sait aujourd’hui que la guerre des Six Jours fut largement une guerre du pétrole. On sait moins que la guerre du Viêt-Nam en est une autre. Dans leur ouvrage « La guerre secrète du pétrole », Jacques Bergier et Bernard Thomas rappellent que « Malgré les liens privilégiés qui les unissent, les Britanniques ont toujours été de dangereux rivaux pour les États-Unis. Les grands “Maîtres du pétrole” des deux pays (Standard Oil “Chevron-Mobil-Exxon”, Texaco, Gulf, Royal Dutch-Shell, British Petroleum, etc.) se sont de tout temps livrés une guerre acharnée. ».
Pour la petite histoire, c’est en août 1859, le 27 précisément, qu’un aventurier de Pennsylvanie, Edwin L. Drake, allait découvrir le premier puits de pétrole du monde. Aussi, notons que depuis 1859 le monde a été secoué par deux guerres mondiales dont la seconde a élargi ses fronts à la terre tout entière. Durant ces deux guerres mondiales, des conflits larvés, des guerres civiles, des coups d’État, aux conclusions curieuses, ont régulièrement déchiré les pays riches en ressources énergétiques. Tout cela ne signifie pas que la course à ces ressources est seule à l’origine de tant de malheur dans le monde depuis près de deux siècles. Néanmoins, sous couvert d’idéologies diverses, elle est l’une des raisons réelles de tous les conflits et les coups d’États.
La catastrophe provoquée en Occident par le manque de pétrole serait inimaginable. Alors, lorsque les nations ne sont plus en état de guerre, les grands trusts rivaux utilisent d’autres méthodes pour contrôler la manne énergétique : le sabotages, comme celui Canal de Panana en 1926 ; l’incendie de puits, comme celui des puits Roumains de Moreni en 1929 ; « l’accident », comme celui survenu en 1962 avec le crash de l’avion dans lequel se trouvait Enrico Mattei, l’homme qui avait engagé pour le compte de l’Italie, son pays, une dure bataille contre les trusts anglo-saxons ; alors directeur de l’E.N.I., (Ente Nazionale Idrocarburi), E. Mattei gênait beaucoup de gens. Cet homme seul, mais attaqué de toutes parts, avait réussi à pousser son gouvernement dans la voie d’une véritable indépendance pétrolière. Mais aucun des deux plus grands trust mondiaux du Pétrole, l’Américain et le Britannique, n’acceptera qu’une troisième puissance pétrolière puisse intervenir sur le marché mondial. Rappelons encore que c’est au moment où la Royal Dutch-Shell prenait pied au Sahara, en 1954, que la rébellion allait naître en Algérie.
Dans la foulée de l’effondrement de l’économie britannique à la fin des années 60, allait également commencer la lente agonie du Dollar avec la désastreuse guerre du Vietnam.
En 1971, les USA n’ayant plus suffisamment d’or pour garantir l’intégralité des dollars en or, survient la fin de sa convertibilité dans ce métal précieux. Aussi, à partir de cette date, le dollar américain, en tant que monnaie mondiale sera désormais adossé au pétrole ainsi qu’à la seule force de l’économie américaine (via son dynamisme économique intérieure). Concrètement, à partir de ce moment-là, la valeur du dollar ne repose quasiment plus que sur la force brute des USA, c’est-à-dire leur capacité à faire militairement et monétairement respecter leur hégémonie dans les pays tiers.
Au niveau international, il résulte de cette situation la substitution de la notion d’« ordre juridique » par un retour à la « loi du plus fort ».
Le début des années 1970 sera aussi le début d’une grande dérégulation financière. Alors surviendra la « fabrication artificielle des actifs » (Subprimes, CDS ou « Credit Default Swaps », etc.), ainsi que la captation des réserves monétaires des pays tiers, c’est-à-dire les pays dits « alliés », les membres de l’U.E., etc., véritables « colonies » financières. On comprend alors, en partie, le pourquoi de la mise en place, en France, de la loi du 3 janvier 1973 qui modifie les statuts de la Banque de France et donne le coup d’envoi d’une dette qui augmentera incessamment et vampirisera toutes les richesses nationales produites.
Mais la France n’est nullement un cas isolé. Les dettes de tous les Etats, aidées par la conjuration de toutes les élites économiques (« sous influence ») des différentes nations, sont devenues des océans impossibles à écluser et les nations sont ficelées au bon vouloir d’institutions financières privées, de plus en plus arrogantes et gourmandes.
La titrisation, en faisant circuler dans le monde entier des « actifs douteux », associée à l’internationalisation du droit anglo-saxon (« Soft Law », Lobbying, Trust, propriété économique, etc.) permettront à ce système de fonctionner.
À compter des années 1990 (Chute de l’URSS, création de l’U.E., etc.), pendant que le « dynamisme économique intérieure » de l’Amérique faiblit, les besoins du dollar s’intensifient considérablement en raison du développement inédit des échanges économiques internationaux en même temps que celui de la concentration des capitaux (mise en place du libre-échange par l’OMC, organisme mondialiste tout comme l’OCDE qui favorise l’optimisation fiscale, etc.).
La solution de la « planche à billet » étant dorénavant exclue, les banquiers innovent avec le « Quantitative Easing » (QE). La création monétaire est désormais adossée à des rachats d’actifs de plus en plus pourris en raison de la dérégulation financière qui s’accentue (avec la bêtise et l’ignorance, la plus dangereuse des « pandémies » est la « soif de l’or »). En conséquence de cette « fuite en avant », le circuit financier international est devenu « non viable », ainsi que l’avait anticipé J.M. Keynes à Bretton Woods : une monnaie nationale était structurellement inapte à répondre au besoin d’une monnaie mondiale.
Le magazine « The Economist » avait, dès 1988, « prévenu » le public du fait qu’un panier de monnaies, le « Bancor » cette devise internationale originellement proposée par le « Fabian » Keynes en tant qu’étalon monétaire international, et que nous voyons d’abord apparaître sous la forme de D.T.S. (Droits de Tirage Spéciaux) au début du XXIème siècles, allait, tel le phénix, renaître de ses cendres autour des années 2018 (voir la couverture de « The Economist »).
L’avènement de cette monnaie mondiale « DTS-Bancor » a été préparé, dans le secret, comme beaucoup d’autres avènements.
Le président étasunien F.D. Roosevelt disait : « En politique rien n’arrive par hasard. Chaque fois que survient un événement, on peut être certains qu’il avait été prévu pour se dérouler de cette façon. »
C’est pourquoi, actuellement, nous assistons à de grandes manœuvres géopolitiques consistant en la « démolition contrôlée » (devenue une habitude depuis un fameux mois de septembre) du dollar par l’entremise, plus ou moins adroite, de remise en cause de la suprématie américaine sur les échanges internationaux.
La Chine et la Russie, qui sont, rappelons-le, membres de la BRI, sont parties prenantes de cette stratégie : la Chine en tant que moteur principal des DTS tandis que la Russie a raccroché les « wagons du train » de la monnaie mondiale.
Aussi, et sous l’égide de la BRI, la prochaine étape de la stratégie, jusqu’ici gagnante, des « puissances d’argent » sera la mise au point d’une monnaie mondiale. Cette future monnaie, qui chapeautera toutes les monnaies du monde, devra circuler sous forme exclusivement dématérialisée.
Une fois en place, cette monnaie dématérialisée contrôlera parfaitement et définitivement la vie privée de tous ses utilisateurs, alors même que personne ne pourra échapper à cette dématérialisation monétaire pour les échanges nécessités par la vie courante.
« Celui qui contrôle la monnaie d’un peuple, contrôle ce peuple. », disait le président des États-Unis, J.A. Garfield, farouche partisan d’un « argent honnête », élu en 1880… et assassiné en 1881.
Par conséquent, celui qui contrôlerait la monnaie du monde contrôlerait le monde.
C’est pourquoi l’avènement de cette monnaie mondiale sera le premier pas institutionnel vers le gouvernement mondial oligarchique.
Le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) est l’un des mécanismes clés dans le cadre du financement de la future monnaie mondiale.