L’APRES-KØVÍD: PROLÉGOMÈNES À UN NOUVEAU MOYEN-ÂGE
Source : cultureerracines.com -23 janvier 2022 – Modeste Schwartz
https://www.cultureetracines.com/actualites/lapres-kovid-prolegomenes-a-un-nouveau-moyen-age-n724
Abonnez-vous au canal Telegram Strategika pour ne rien rater de notre actualité
Faites un don pour soutenir l’analyse stratégique indépendante
De Hamvas et Spengler à Slavsquat, en passant par Kojève, Kubrick, Curtis… Un article de Modeste Schwartz pour entrer dans le 3e millénaire.
Modeste Schwartz est écrivain, journaliste et grand voyageur. Spécialisé dans la Roumanie, la Moldavie et le Sud-est de l’espace post-soviétique, il est un chroniqueur régulier du Visegrád Post. Il est l’auteur de Yin, au éditions Culture et Racines.
Il y un peu plus d’un an de cela, j’ai commencé, dans mes conversations (surtout de messagerie) avec quelques-uns des esprits éveillés de notre époque, à parler de « Køvíd », pour parler de ce qui – tout du moins aux yeux du public – a commencé en février-mars 2020, et qu’une majorité (en peau de chagrin, cela dit) dudit public continue encore, au moment où j’écris, à prendre pour une « crise sanitaire ». A travers cette innovation lexico-graphique, il s’agissait pour moi de manifester non seulement le rejet du récit officiel (de type « O.M.S. ») actuellement en cours d’effondrement, mais aussi de prendre mes distances avec les courants de pensée alter-covidistes surgis au cours de l’été 2020, lesquels, stupides ou complices, s’employaient déjà à valider par la bande le récit du mainstream, en l’assortissant de menus addenda (parfois exacts, mais jamais pertinents), sur le « gain de fonction », la « 5G » ou « l’Ivermectine » : autant de façon de ne pas comprendre ce qui venait d’arriver – c’est-à-dire, d’un point de vue sanitaire : pratiquement rien ; et, d’un point de vue politique : la fin d’un monde, qui était à la fois celui de la rationalité calculante, de l’universalisme démocratique et du droit afférent à ce dernier – la fin de l’Occident[1].
Mais, puisqu’il ne s’agissait pas d’une crise sanitaire – ni « naturelle » (ou à causes « climatiques »), ni « artificielle » –, de quoi s’agissait-il donc ? Le génie exhibitionniste d’E. Macron nous avait, dès le printemps, mis sur la voie : « Nous sommes en guerre ». C’était parfaitement vrai : le Køvíd est une guerre. Quand tous les États du monde s’appauvrissent simultanément sans cause naturelle, c’est généralement qu’une guerre (mondiale) fait rage. Au passage, certes, quelques milliardaires avaient arrondi leur pelote de milliards : toute guerre a ses profiteurs.
Restait donc juste à déterminer qui était entré en guerre, et contre qui. Klaus Schwab, dès le début de l’été 2020, avait fourni une réponse assez claire à la première question, avec son texte portant un titre en forme d’aveu : Covid19 : la Grande Réinitialisation. Pour un ancien orateur des forums de Chișinău (« l’anti-Davos » de Iurie Roșca) comme moi, ce n’était que retomber sur les suspects habituels. Ces gens-là étaient donc partis en guerre ? Mais contre qui ? Ou – autre manière de formuler la même question – de qui avaient-ils donc suffisamment peur pour déclencher une guerre préventive dans laquelle ils mettent en péril un pouvoir, une opulence et une tranquillité sans précédents dans l’histoire humaine ? Formulation des plus intéressante, néanmoins, dans la mesure où elle suggère d’emblée que la réponse qu’on apportera à cette question pourra aussi être une réponse à la question de l’après-Køvíd : ce dont Davos a eu si peur, c’est peut-être aussi ce qui, une fois Davos défait, serait susceptible de parachever sa destruction, c’est-à-dire son remplacement par une formule culturelle viable.
Guerre civile ou atomisation de la guerre ?
Ce qui a, au début, considérablement entravé la compréhension du problème, c’est la forme prise par cette guerre – caractérisée, notamment, par l’absence de tout front territorial. Certains ont cru le deviner quelque-part à la hauteur de l’ancien Rideau de fer – la trahison covidiste des « illibéraux » de l’Est (d’abord Orbán, puis Poutine – le jeu de la Chine ayant toujours été ambigu) leur a apporté un démenti cinglant. Et pourtant, il n’est, à mon avis, pas faux d’affirmer que, d’un certain point de vue (essentiel), cette Troisième Guerre mondiale[2] est bien la continuation de la Guerre froide – elle-même épiphénomène de cette séquence 1914-45 parfois appelée guerre civile européenne.
Il est hors de doute que les premiers à avoir usé de cette expression l’ont principalement fait dans la perspective théorique d’une unité politique de l’Europe – dérivant elle-même d’une conception naturaliste[3] des « grands ensembles » « appelés » à dominer « l’échiquier géopolitique »[4].
À vrai dire, tout comme les marxiens ne réussiront jamais (et pour cause) à remonter au-delà d’Adam Smith, les géopoliticiens sont programmatiquement incapables de comprendre l’avant et l’après de l’absolutisme moderne[5]. Ce sont deux formes (certes divergentes, mais homogènes) de myopie anthropologique.
Du coup, ce concept assez fécond de guerre civile européenne a, jusqu’à présent, été plutôt gaspillé que mis à profit. Plutôt que de servir de véhicule pseudo-conceptuel à des idées élégiaques sur la division de ce qui « aurait dû être uni »[6], il aurait pu (et peut encore) nous aider à comprendre comment une société atomisée ne peut qu’atomiser la guerre.
Après les États : l’État. Et après l’État ?
Le moment géopolitique de l’histoire humaine doit avant tout être compris comme celui de la constitution des États. Mais, à peine constitués, ils se simplifient (on passe des États à l’État), pour, aussitôt après, disparaître. Une fois la phase de constitution dépassée, la géopolitique devient (généralement sans s’en rendre compte) une science historique – typiquement incapable, entre autres, de prédiction efficace[7]. A l’été 2020, les « géopoliticiens » ont exhibé cette incapacité, en accouchant, en désespoir de cause, de divers alter-covidismes.
Notons au passage que dans cette histoire, la nation est une parenthèse presque anecdotique : dans les moments de ralentissement de cette dynamique[8], à la faveur d’une réinterprétation ethnique, assez bancale, de l’idée révolutionnaire française, l’Europe centrale et centre-orientale s’est adonnée à ce jeu assez vain de l’État non-impérial. Du Pacte Molotov-Ribbentrop à la nucléarisation de la puissance, en quelques décennies, l’histoire à tiré le rideau sur ce trouble adolescent.
Or, dès leur naissance, les absolutismes sont mimétiques : pour faire de la Russie un État, Pierre l’anglicise[9]. Victimes d’idiosyncrasies idéologiques qui les éloignent du tronc commun, la France (pourtant porteuse du prototype) et l’Allemagne (challenger tardif), elles, se font reléguer en division proconsulaire. Pierre en admiration devant le port de Londres ouvrait un chemin qui ne pouvait mener qu’à Yalta.
Car, à son terme, le processus ne peut déboucher que sur un face-à-face comme celui que le génial Kubrick saisit avec une telle plasticité dans son Docteur Folamour (1964). Généralement résumé de façon réductrice à une mise en garde contre le danger de l’autodestruction nucléaire, ce chef-d’œuvre cinématographique montre néanmoins aussi un processus plus subtil et (politiquement, du moins) plus essentiel : l’autodestruction de la géopolitique. Que la glissade nucléaire puisse ou non être évitée, les protagonistes (oligarchiques) du film se montrent, en tout état de cause, bien plus (voire uniquement) préoccupés par la perpétuation – sous prétexte de compétitivité géopolitique – de leurs privilèges, c’est-à-dire par la guerre civile occidentale[10]. Si ladite glissade, dans le film, finit tout de même par se produire (sans guère altérer, au demeurant, la mentalité des protagonistes), c’est par la faute du général Ripper : un retardataire idéologique[11], qui commet l’erreur fatale de croire à l’idéologie justificatrice de ce face-à-face géopolitique dont il est la dupe – alors qu’il devrait, en vertu de son rang, participer à la mise en scène.
Ce qu’incarne parfaitement même une lecture pacifiste gnangnan (la plus courante) du film, c’est l’idée que personne (pas plus à Moscou qu’à Washington) ne veut vraiment mourir, non seulement pour « le capitalisme » ou « le communisme », mais, à vrai dire, pas vraiment non plus pour « l’Eurasie » ou « l’Occident ». Et pour cause : la vérité immanente que tous, alors, comprennent déjà (bien que personne – en-dehors, tout au plus, de Kojève – ne soit encore en mesure de la formuler), c’est que « l’Eurasie » et « l’Occident » sont une seule et même chose. Les Etats existent du fait de la perte de la Communauté[12] : ils sont la prothèse pénienne de l’univers politique humain, tout entière destinée à structurer du dehors (à la manière du corset) ce qui a de moins en moins d’endosquelette.
1789-2020 : l’âge idéologique
En « prévenant » la guerre de tous contre tous[13] – unique conséquence possible de l’essor de l’individu – l’Etat organise cette guerre, la police et la pérennise. Et, quand les énergies de cette guerre civile permanente ne tiennent plus dans cette boite de Pandore de l’Etat, il les libère à l’extérieur : d’abord en planétarisant l’Etat via la colonisation, puis[14] en se retournant contre les autres Etats, lesquels, ipso facto deviennent vite l’Autre Etat – c’est-à-dire, essentiellement, contre lui-même. Lubrifiant de la partouze, l’idéologie accompagne consciencieusement les opérations, secrétant au passage son personnel spécialisé : l’intellectuel, fluffer de l’Etat, fournisseur patenté de raisons de s’identifier, c’est-à-dire de raisons de mourir pour le compte de ceux qui ne sont pas dupes de ces identifications.
La version initiale (« westphalienne », pourrait-on dire) de cet exercice atteint ses limites entre 1914 et 1918 : à l’exception de l’Empire ottoman[15], tous les belligérants luttent pour la paix, la prospérité, le progrès et la justice. Mais surtout, tous ont à cœur la patrie – ce qui les amène tout naturellement à l’envoyer, la patrie, se faire déchiqueter devant des nids de mitrailleuses, lacérer par des barbelés et empoisonner par les gaz de combat. Retour des tranchées, les survivants ont pratiquement tous appris cette leçon de l’immanence, qui, jusqu’à la fin de leur vie, se cristallise politiquement sous la forme du pacifisme européen. Les patries sont mortes.
En préparation de ce match retour passé aux annales sous le nom de Deuxième Guerre mondiale, l’idéologie, elle, tente son quitte-ou-double : on ne se battra plus pour l’endroit où l’on est né, mais pour son heureuse intégration dans l’Empire du Bien ; le « progrès » n’est plus une conséquence du patriotisme, mais la justification même de l’État impérial, qui devient ispo facto la forme territorialisée de ce que, dès l’époque des guerres de religion, on appelait un parti. Depuis les années 1920 et leurs corps francs, toutes les armées tendent à devenir des brigades internationales – et le deviennent, avec la Guerre froide, de façon pratiquement officielle, dans le cadre du Pacte de Varsovie et de l’OTAN. Après élimination du « troisième luron » européen, le monde bipolaire est la dernière chance de territorialité que l’histoire offre à l’Etat.
A partir de 1991, cette chance s’est évanouie. Dès lors, l’idéologie, à son tour, se déterritorialise : ce que d’aucuns ont décrit sous le nom d’hypernormalisation[16], c’est en réalité avant tout la reformulation atomique du récit de l’État : l’ennemi externe n’est plus un autre État[17], mais d’abord la menace « moléculaire » du terrorisme – surtout islamique. Mondialement officialisé, dix ans presque jour pour jour après la dissolution de l’URSS, par le grand show du 11 septembre 2001, ce beta-testing montre cependant assez vite les limites du modèle « menace islamique », encore trop facilement fixable – en tant que l’Islam (que ce soit sur la mappemonde ou sur le plan des mégapoles occidentales) a encore sa géographie, ses ethnicités, ses langues : une clôture, répondent les retardataires « illibéraux », quelques barbelés, et il n’y paraîtra plus.
En passant de septembre 2001 à mars 2020, il faudra donc passer du « moléculaire »[18] au nanométrique : ce n’est plus dans le quartier, mais dans l’organisme, que le bon nano va combattre le mauvais.
Aux retardataires incapables de faire leur deuil de feu la géopolitique, le covidisme jette alors un dernier os, sous la forme d’une guerre des sérums : les « atlantistes » veulent leur Pfizer, tandis que les « eurasistes » croient en Spoutnik V. Ces derniers y croient, à vrai dire, si modérément que la course au vaccin pourrait bien, in fine, avoir les mêmes conséquences que la course à la bombe : simplifier territorialement l’Occident de facto, en annulant quelques illusions passagères comme la « Fédération de Russie » ou la « République de Hongrie ».
Prolégomènes à une étique post-covidiste
Car, de Giorgio Agamben à Eduard Slavsquat, tous les esprits réellement contemporains comprennent bien que cette géopolitique est factice, les belligérants de la guerre civile occidentale en cours étant tous deux multinationaux. A ceci près que, tandis que (au centre du système, tout du moins) l’Etat devenu corporatocratie assume presque ouvertement ce caractère[19], son adversaire (nous) continue, le plus souvent, à s’imaginer comme une pluralité complexe (« les peuples »), alors même que les raisons qui poussent un possesseur de smartphone à accepter ou à refuser une injection, de Los Angeles à Vladivostok et de Téhéran (centre-ville) à Oslo (banlieue comprise), sont sensiblement les mêmes. Tandis que les oligarques, en dépit d’une relative bigarrure linguistique et confessionnelle, se savent membres (eux, et nul autre) de la Communauté Internationale, nous autres, nous devons, à cette guerre que nous mène l’État, survivre conceptuellement alourdis par une croyance anachronique dans les États (voire, pour les plus retardataires : les nations).
L’écologisme (pendant exotérique de la religion de Gaïa) fournit au parti oligarchique une idéologie à la mesure de ses besoins, c’est-à-dire définissant une pseudo-patrie qui (comme la sécurité « climatique » ou « virale ») ne peut être que planétaire[20], et identifiant potentiellement le gros de la population humaine comme le Camp du Mal (au titre, notamment, de la surpopulation). En face, « les peuples » restent mentalement poissés dans des représentations anachroniquement territoriales et catégorielles : Philippot pense défendre « la France », comme si l’ouvrier et le boutiquier allemands réagissaient mieux à l’ARNm injecté – et comme si une bonne partie des organisateurs du génocide de domestication en cours n’étaient pas, comme lui et moi, des citoyens français[21] ; d’autres croient combattre « les nantis » – alors qu’en deçà des propriétaires d’avions et d’îles, il n’existe objectivement plus que des mangeurs inutiles[22]; etc..
Il a fallu que l’État, après avoir prospéré pendant des siècles en exploitant la tendance des sociétés à l’atomisation individuelle, parvienne jusqu’aux portes biologiques de l’individu lui-même pour qu’on voie apparaître – suivant une logique immanente – la première ébauche des principes organisateurs d’une société parallèle à l’État, par exemple sous la forme de réseaux séparatistes permettant aux non-injectés (à divers degrés) de réduire au minimum leurs interactions sociales avec les injectés (des divers degrés). Si cette logique s’étend (comme on peut le souhaiter) aux relations sexuelles et reproductives, elle débouchera fatalement sur la formation de castes.
Caste contre caste : retour du sang sur la scène de l’histoire
Et on ne peut, en effet, que remarquer une parfaite logique immanente dans cette formation spontanée de castes d’intouchables, les organisateurs du Reset s’étant, pour leur part, organisés en caste longtemps avant le Premier Confinement. Mimétisme descendant, bien connu, entre la base et le sommet de la pyramide sociale : les membres du Club de Davos ne sont plus censés appartenir à un même parti idéologique, ils ne sont pas camarades et ne prétendent même plus disposer de quelque mandat de représentation que ce soit ; ni même coreligionnaires – au sens, du moins, des religions exotériques ; ils présentent, en revanche, deux caractéristiques bien connues des élites de l’époque de la (petite) mondialisation moyen-orientale du IIe millénaire avant l’ère chrétienne : une consanguinité croissante (allant jusqu’à l’inceste), et la conscience de plus en plus explicite d’incarner (via la « philanthropie », l’awareness etc.) le Bien. C’est cette spécificité qui, dès le début « du Covid », a donné aux antisémites – entraînés à la critique d’une structure de pouvoir tribaliste – une longueur d’avance sur d’autres dans l’analyse.[23] En tant qu’elle devient consciente d’elle-même, cette violence auto-séparatrice de la caste émergente des intouchables ne fait d’ailleurs qu’intérioriser une violence systémique qui, depuis les premières lois mémorielles adoptées au cours des années 1980, tend à alourdir toujours plus le cahier des charges symbolique (et, depuis peu, chimique) du citoyen respectable, qui doit non seulement avoir une vision bien précise de l’histoire[24], mais aussi un certain nombre de sympathies (ou tout du moins, d’absences d’antipathies) le mettant à l’abri du soupçon de phobies, et même, depuis peu, un certain nombre de substances dûment injectées – au point d’euthanasier discrètement l’universalisme démocratique. La démocratie libérale est ainsi devenue implicitement bolchévique[25] : conformément au dogme progressiste de l’infinie réformabilité de l’homme, les seuls critères d’exclusion qu’elle affirme refuser sont ceux qui tiennent de l’inné (caste, race, « orientation »[26]) ; par ailleurs, l’État impose à l’individu 100% des déterminations culturelles (et, depuis peu, biologiques) qu’il peut lui imposer – si bien que l’idée même d’un citoyen non-camarade devient une pure vue de l’esprit (d’où monopartisme de facto), de même que tout principe de détermination ascendante (des institutions par la « société civile »). C’est ainsi que la société ouverte est morte aux mains de ceux-là même qui en avaient fait leur cheval de bataille.
Ainsi, c’est dans la réaction des exclus que le virage covidiste a introduit une évolution qualitative marquante : avant les injections (de facto) obligatoires, ces réactions relevaient avant tout de la récrimination ; le virage bolchévique étant déclaré inique, les refuzniks demandaient (implicitement : au parti) leur réintégration au corps civique. En falsifiant des QR et en réseautant entre eux, certains de ces mêmes refuzniks (entre-temps devenus « antivaks ») renoncent de facto à cette citoyenneté zombie, pour s’engager (au début, presque toujours sans l’avoir voulu) sur la voie d’un nouveau contrat social. Lequel pourra certes prendre (entre autres) des formes démocratiques lato sensu, mais certainement plus la forme de la démocratie universaliste de feu les États-nations démocratiques. Au passage, c’est aussi (comme de droit) l’homo economicus qui commence à mourir, étant donné que, tandis que l’oligarchie sacrifie ostensiblement le PIB au Great Reset[27], les « antivaks » prennent quotidiennement des décisions contraires à leur intérêt chrématistique, de façon à préserver ce qu’ils estiment constituer leur intégrité corporelle (la pureté du sang) – et qui constitue sans aucun doute possible leur intégrité morale, c’est-à-dire leur (véritable) identité. Pour se structurer (et donc se hiérarchiser) parallèlement à l’État et contre ce dernier, cette nouvelle société a néanmoins besoin d’une doctrine dépassant la théologie négative de la protestation anarchisante, de façon à rendre possibles et régulières les interactions sociales jadis régulées par un État entre temps devenu matrice injectale de la ruche transhumaine[28]. Comme toute idéologie, cette doctrine ne pourra pas ne pas épouser les contours de l’immanence à laquelle elle propose ses services intellectuels : en ce sens, il s’agit moins de rêver un monde que de rendre plus logique et plus conscient de lui-même un monde qui émerge de lui-même. Mais de la cohérence et de la radicalité de cette doctrine dépendra aussi la viabilité des modèles sociaux qui dériveront du passage au positif de cette expérience née (comme tant d’épisodes historiques) d’un simple (mais adamantin) refus. Dire non, c’est souvent, en soi, la naissance d’un monde – mais pour pouvoir grandir, il ne lui suffit pas d’être né.
Notes : [1] Ou pour le moins d’une séquence centrale de ce dernier étamée au plus tard au moment de la Renaissance et… de la Grande Peste. L’histoire a de ces ironies, pas toujours innocentes.[2] Certains ont préféré parler de Quatrième, en réservant le titre de Troisième à la Guerre froide. C’est probablement donner trop d’importance, à cette dernière – ou plutôt : trop d’existence : à partir de la Crise des missiles de Cuba (qui referme en réalité le segment ouvert par la défaite allemande de Stalingrad), il n’y a plus eu, entre URSS et Bloc Occidental, qu’un mopping-up kojévien du passif idéologique.[3] Avec ou sans « race » – différence qui, avec le recul, semble assez secondaire.[4] C’est la tradition que perpétuent encore des penseurs intellectuellement respectables (quoique totalement anachroniques) comme R. Steuckers. Comme – en dépit de pionniers comme Mac Kinder – le gros de ce corpus théorique date de l’entre-deux-guerres, on peut dire, sur un ton hégélien, qu’une fois de plus, la conscience du phénomène (en l’occurrence : géopolitique) s’est épanouie dans les rayons de son crépuscule. [5] Généralement assorti dans les descriptions et les théories, par souci d’exhaustivité et de lustre, de ses précurseurs de l’époque de la « première mondialisation » moyen-orientale. Et il est, en effet, indéniable que – par exemple par l’institution de gouverneurs eunuques à la tête de leurs provinces – les empereurs assyriens ont anticipé « en petit » beaucoup des « inventions » biopolitiques actuelles du pouvoir oligarchique – issu, quant à lui, d’un absolutisme européen qui, pour émerger, a d’abord dû liquider la petite noblesse du Moyen-Âge chrétien.[6] Leitmotiv bien connu de la pensée magique, de la poésie, et donc aussi de ceux qui, faute de comprendre l’histoire, de pouvoir et même souvent de vouloir agir sur elle, se réfugient dans ce genre de poésie historique qui, à la faveur de l’idéalisme romantique, a souvent pu se faire passer pour une pensée politique. [7] Toutes ces conclusions s’appliquent, bien entendu, à l’Etat occidental – devenu, via la colonisation, la forme mondialement presque exclusive de la vie étatique. Ce qui n’oblitère bien entendu pas les profondes différences culturelles séparant les sociétés sous-jacentes aux Etats formels du monde post-colonial de celles des Etats organiques du berceau occidental (et de ses pseudopodes exotiques : Australie, Cono Sur…) – différences susceptible d’émerger à nouveau à la surface de l’histoire, notamment au moment (présent) de simplification/dissolution de l’Etat (occidental). L’Occident dont il est ici question est néanmoins un Occident lato sensu, incluant non seulement l’Europe de l’Ouest et ses anciennes colonies de peuplement, mais aussi l’Europe centrale et centre-orientale, ainsi que le monde russo-soviétique (et probablement aussi la Corée et les pétromonarchies arabes et turciques) – la propagation du covidisme fournissant, en l’occurrence, un marqueur efficace.[8] Et notamment entre Empire napoléonien et Guerre froide : le siècle et demi de ce qu’on pourrait, en histoire des idées politiques, nommer « âge romantique ».[9] Ou la polonise faute de mieux, l’anglais étant alors pour lui un article d’importation, aussi cher que lointain.[10] Laquelle, sous les dehors folkloriques si typiques du petit frère russe, fait bien entendu aussi rage à Moscou.[11] Rejeton WASP du IIIe Reich, Ripper, à qui le scénario réserve d’ailleurs une fin identique à celle du Führer dans son bunker, exprime un discours délirant centré autour de la notion de pureté : idéologie de l’inné, en contradiction avec le bolchévisme d’ores et déjà planétaire (comme l’avait très bien vu Kojève plusieurs années avant le film de Kubrick) dont les deux écoles concurrentes, entre la war room de Washington et une garçonnière moscovite, dialoguent par le téléphone rouge.[12] Comprise ici au sens de B. Hamvas, notamment dans sa somme Scientia sacra.[13] Mission qui constitue, depuis Locke, sa mission explicite.[14] A ce moment, que Lénine a assez justement saisi, où l’Etat atteint les limites de la Terre.[15] Déjà agonisant, et qui – trop occupé à exterminer ses minorités, dans l’espoir d’accoucher anachroniquement d’une nation turque – ne se bat guère à l’extérieur.[16] Pour reprendre le titre de l’excellent documentaire d’Adam Curtis – lequel décrit le demi-siècle suivant 1968 avec un certain réalisme, mais sur le ton élégiaque d’un gauchisme peiné de constater que mai 68 n’a pas tenu ses promesses. Or l’intelligence de l’histoire consiste, bien au contraire, à comprendre comment les (véritables) promesses de mai 68 ont non seulement été tenues, mais ne constituent même, à vrai dire, que la formulation la plus avancée d’une promesse occidentale bien plus ancienne, et totalement coessentielle au concept même de culture occidentale.[17] Hormis deux ou trois shithole countries anachroniquement soustraits à la bienveillance responsable de la Communauté Internationale, et dûment bombardés entre 1991 et 2014, il n’y plus d’autre Etat : en ce sens, au moins, le système devient sincère.[18] Métaphore très révélatrice qui a fait florès dans la littérature « anti-terroriste » des années 2000, pour décrire le mode d’organisation « totalement inédit » qu’auraient adopté les réseaux djihadistes. Ce qui était réellement inédit (quoique pas vraiment imprévisible), c’était, bien entendu, surtout la propagande à l’origine de ce thème, déjà très proche structurellement du discours covidiste : « si Internet risque de propager le (virus du) Djihad en quelques clics, ne vaudrait-il pas mieux mettre un terme à la liberté numérique ?[19] Ses principaux centres de pouvoir étant officiellement connus sous le nom de « (compagnies) multinationales », tandis que ses délibérations au sommet cachent leur nature unilatérale sous une fine gaze verbale de « multilatéralisme ».[20] Aucune jet set ne contenterait de moins. Quant à ce qu’il convient de penser de la réalité concrète de cette globalité, cf. note 5 supra. [21] Voire, comme lui, des français de souche.[22] Pour reprendre la terminologie chère à Bill Gates.[23] Longueur, hélas, souvent gaspillée sur l’autel d’anachronismes théoriques comme le racisme scientifique – alors que, comme Marx l’a, mieux que quiconque, exposé dans Zur Judenfrage, il y a, en Occident, fort longtemps que la « question juive » a cessé d’être une question strictement ethnique.[24] Et, depuis peu, de la climatologie.[25] Pour pousser l’exactitude jusqu’à la méticulosité, on pourrait même dire : trotskyste, dans la mesure où l’ouvriérisme au parfum narodnik de la période stalino-bréjnévienne lui est parfaitement étranger. Cet ouvriérisme (la préoccupation des « origines sociales saines ») est d’ailleurs au centre de l’argumentaire anti-communiste des illibéraux de l’Est, qui révèlent au passage, en creux, la vraie nature de cet anticommunisme (généralement arboré par des apparatchiks reconvertis, et par leur descendance personnelle et politique) : s’il est certes criminel pour eux d’empêcher un fils de notaire d’accéder aux universités (c’est presque aussi grave que le numerus clausus !), c’est bien là la seule violence d’Etat à laquelle ils ne consentiraient pas – comme l’a finalement prouvé le zèle dont ils ont fait preuve au service de ce nouveau bolchévisme qu’est le covidisme. Pour les trotskystes (remaquillés ou non au fard illibéral), les enfants de la bourgeoisie (et notamment de la bourgeoisie d’Etat) doivent avoir la liberté de participer au grand-œuvre de rééducation progressiste du peuple (et notamment des prolétaires insuffisamment éclairés).[26] Ce dernier point faisant d’ailleurs, depuis une dizaine d’années surtout, l’objet d’une controverse ético-politique, entre le mouvement gay (qui avait construit son pouvoir sur l’affirmation de droits enracinés dans des orientations constituant des identités non critiquables car innées – sur le modèle de l’antiracisme) et le mouvement queer, sorte d’existentialisme des parties, qui ne veut entendre parler d’aucune identité, et pour lequel, même délicieusement déviant, l’inné est par définition le mal absolu.[27] Chose dont certains « dissidents » (a priori plutôt naïfs) ont même réussi à se réjouir au printemps 2020… C’est (entre autres) à l’anatomie de cette Bérézina « dissidente » qu’est consacré le troisième tome de ma trilogie, Roman (encore inédit), tandis que l’idéologie du sacrifice lui-même (de la Grande Réinitialisation) est analysée dans mon Magicien de Davos (tome II, éditions Cultures & Racines, 2021).[28] Dans l’attente d’un effondrement qui, certes, ne saurait tarder. Mais, comme on ne détruit vraiment que ce que l’on remplace, c’est de la viabilité d’un éventuel modèle parallèle que dépendra en grande partie celle d’un éventuel modèle de remplacement (à moins que les représentants d’autres cultures ne se chargent entre temps d’occuper la vacance de facto du pouvoir culturel en Occident).

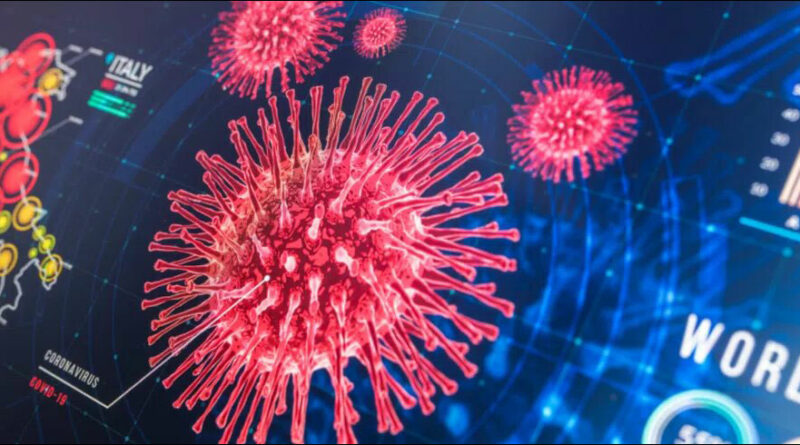



En lisant le tìtre de cet article, avec sa référence au Moyen Age, je croyais que j’allais lire une analyse de l’abrutissement contemporain, de la dégénérescence intellectuelle, de la moutonnisation (si on peut dire en francais). Mais cette hypothèse ne s’est pas vérifiée. Je ne comprends donc pas bien le tìtre.
Analyse intéressante, mais aussi abstraite, très intellectuelle, et pas facile à lire; et, à mon avis, erronnée sur deux points:
Premièrement, la géopolitique n’est par morte du simple fait que le champ de bataille se complique d’une superimposition d’une couche covidiste.
Deuxièmement, vérité hérétique et déjà censurée sur ces pages, la bombe atomique et donc le spectre de l’autodestruction nucléaire, pour autant que la propagande de la Guerre Froide s’y référait, voire s’y appuyait comme support primordial et principal, n’ont jamais existé. (Comme ce commentaire risque d’estre supprimé à son tour, au mesme tìtre que l’ont été deux autres, je ne vais pas gaspiller plus de mots là-dessus pour l’instant.)
Je suis en parfait accord avec l’auteur de cet article sur la segmentation de l’histoire à partir de 1914 – guerre civile (et catastrophe) européenne, guerre froide (domination par des puissances extérieurs et qui continue jusqu’à nos jours), interlude terroriste, et – qui sait? – époque pandémique si on n’arrive pas à leur casser le jeu, ce qui reste à voir.
Mail il faut analyser le coronavirus comme bombe atomique de nostre époque et vice versa. Ce n’est qu’un mirage de propagande mensongère.